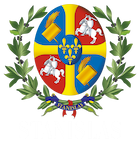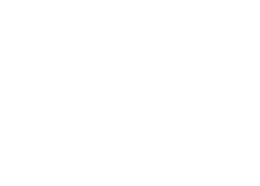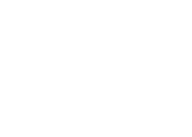Gaspard Koenig, philosophe, publié le 8 janv. 2025 dans Les Echos
Ces dernières semaines, j’ai pris le train à un rythme quasi quotidien, pour des raisons hélas tout sauf festives. J’ai donc eu amplement l’occasion d’observer mes compagnons de voyage rivés sur leurs fils d’actualité, le visage blafard, les traits tendus, les pupilles sautillantes. Et j’ai été saisi d’une impression angoissante, celle de me trouver dans une salle de shoot sur rails, entouré de drogués en plein bad trip, chacun dans son univers. Le silence du wagon me pesa alors davantage que les traditionnels hurlements de bébés.
En guise de bonne résolution pour l’année 2025, je vous propose de vous sevrer des réseaux sociaux, comme je l’ai fait il y a bien des années.
Il y a incontestablement une évolution dans l’usage du si mal nommé smartphone dans les transports. Les premiers temps, les passagers se consacraient à leurs activités habituelles en consultant de temps en temps leur téléphone pour se distraire. Puis ils ont intégré ces distractions dans le téléphone même, en y téléchargeant par avance musique, livres ou films. Grâce aux progrès de la connexion, nous sommes entrés dans la phase ultime : le téléphone est devenu non plus le medium mais l’objet même de la distraction. On se cale dans son siège, on ajuste ses écouteurs et, pendant des heures, on fait défiler sur Insta ou TikTok des vidéos de quelques secondes : une influenceuse s’épilant les sourcils, un chien cherchant son chemin dans un labyrinthe, Macron à Mayotte, un coup franc réussi, un extrait de clip, un corps tiré d’un immeuble bombardé, une pub pour une assurance, une archive de Nelson Mandela, un tuto pour réussir des oeufs brouillés, etc. J’ignore comment le cerveau résiste à une telle dose de data.
Mécanismes délétères
De fait, il ne résiste pas. D’innombrables études documentent les mécanismes délétères des réseaux sociaux sur la capacité d’attention, la sociabilité ou les opinions politiques. Les conséquences sont désormais sous nos yeux. La campagne éclair d’un outsider pro-russe en Roumanie, exclusivement menée sur TikTok, a débouché sur une crise politique majeure. La chute de la lecture chez les plus jeunes face à la concurrence des écrans est une réalité attestée par une récente étude du Centre national du livre (le chiffre le plus troublant : 69 % des lecteurs de 16-19 ans font autre chose sur écran en même temps qu’ils lisent). On peine à comprendre pourquoi les pouvoirs publics, si répressifs s’agissant de la consommation du cannabis aux vertus pourtant apaisantes, baissent entièrement les bras devant cette nouvelle et puissante addiction. L’interdiction des réseaux sociaux aux moins de seize ans votée par l’Australie paraît une évidence. Si l’on peut discuter de l’usage des drogues pour les adultes, il est criminel de ne pas en protéger les enfants.
La loi ne suffit évidemment pas. Pour chaque addiction, il faut comprendre sa raison profonde. A regarder mes voisins de siège, le fondement métaphysique des réseaux sociaux me semble clair : tuer le temps. Littéralement. Anéantir chaque seconde. S’extraire de soi. Ne pas laisser la moindre place aux pensées fortuites ni aux rencontres hasardeuses. Comme si la modernité, dans son matérialisme radical, ne supportait pas les interstices de l’esprit. Comme si le burn-out si répandu était en fait une combustion interne, un insatiable désir d’étourdissement. Comme si l’agitation évitait la finitude.
Lire !
Les Français passent en moyenne plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux. Deux heures entièrement annihilées, parties en fumée, qui ne contribueront ni au PIB ni au bien-être, qui ne laisseront ni émotion ni souvenir. En guise de bonne résolution pour l’année 2025, je vous propose de vous sevrer des réseaux sociaux, comme je l’ai fait il y a bien des années après avoir été convaincu par Jaron Lanier (seule exception : LinkedIn, auquel il faudrait vraiment être pervers pour devenir addict). Et de consacrer ces deux heures non pas à tuer le temps, mais à le perdre, à le dilapider en des tâches inutiles qui nous rendent plus vivants, présents à nous-mêmes et au monde.
Que peut-on faire en deux heures ? Marcher, pour atteindre les fameux dix mille pas quotidiens nécessaires à notre équilibre. Dormir, puisque nous avons perdu une heure trente de sommeil en cinquante ans. Devenir un virtuose du violon, un génie du tricot ou un as de l’informatique : selon la règle des dix mille heures imaginée par Malcolm Gladwell, n’importe qui peut réussir dans n’importe quelle discipline après dix mille heures de pratique intensive, soit moins de deux ans au rythme prescrit.
Et puis bien sûr, lire. Si l’on se réfère à la durée des livres audios, il vous faudra une semaine pour l’« Ethique » de Spinoza, un mois pour les « Essais » de Montaigne, et deux pour « La Recherche » de Proust. La recherche de quoi ? Du temps perdu, justement. Car « les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus ».